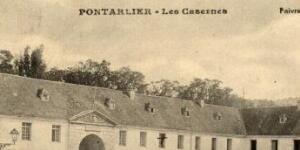FRBMLY-46 Histoire d'une famille dans la guerre.
Une photographie de mariage, un livret militaire, une photo-carte avec son frère, deux photo-cartes représentant ses beaux-frères.
Auguste Louveau était un paysan de la Sarthe s'occupant d'animaux et plus particulièrement de chevaux. Il part en 1911 pour son service militaire qui devait prendre fin en octobre 1914. Surpris par la guerre, il est mobilisé à Alençon (Orne) et affecté dans un service auxiliaire puis au service de la Remonte (3e groupe de compagnie de Remonte). Il y rencontre sa future femme alors cuisinière et obtient une permission pour l'épouser. Démobilisé en 1919, il retourne au Mans.
Son frère Louis a lui aussi fait la guerre ainsi qu'Eugène Achart, son beau-frère (militaire de carrière affecté dans l'artillerie coloniale), et son autre beau-frère, Maurice Achart, fait prisonnier (Darmstad). Ce dernier s'évadera pour rejoindre sa soeur aînée en Belgique.
CONTRIBUTOR
Michelle Achart
DATE
1914 - 1919
LANGUAGE
fra
ITEMS
1
INSTITUTION
Europeana 1914-1918
PROGRESS
METADATA
Discover Similar Stories
FRBMLY-52 Histoire d'une douleur
1 Item
Théodore Loretz, mon grand-père, était d'origine autrichienne. Son père, marié à une Française avait émigré depuis la région du Montafon en Autriche et avait été naturalisé français peu avant la guerre. Il exerçait la profession de plâtrier-peintre (spécialité rustique tyrolien). Il est mort à la veille de la victoire en août 1918 après 4 années de souffrance, d'espoir. Auguste Mille, mon grand-oncle, est mort en 1915, il avait 20 ans, n'avait pas fait son service militaire car jugé trop fragile (mais en assez bonne santé pour partir à la guerre...). Une seule de ses cartes a été retrouvée. Les documents sont présentés pour éviter qu'ils ne tombent dans l'oubli. || 1 photo carte d'Auguste Mille ; Une lettre de Théodore Loretz à sa femme de septembre 1914 ; une lettre de Théodore Loretz depuis Briançon ; une carte officielle des armées ; une lettre adressé à M. Loretz par sa femme mais retournée à l'envoyeur en raison de la mort du soldat ; lettre d'avis de décès.
FRBMLY-72 La vie des civils dans une région envahie : l'exemple d'une famille de l'Aisne dans la zone du front
1 Item
C'est l'histoire de Robert Houssel et de Germaine Cluet mais aussi de leurs familles. La famille de mon père, Robert Houssel est originaire des villages de l'Aisne aux environs de Soissons sur la rive gauche de la rivière. Son grand-père paternel Jean-baptiste, veuf, instituteur retraité, est adjoint au maire de Sermoise, village en amont de Soissons. Sa grand-mère maternelle, Caroline Cluet, veuve, habite Amblemy, en aval de Vic-sur-Aisne. Son père, Maurice Houssel est instituteur et secrétaire de mairie à Trosly-Loire . Il a deux enfants, Robert, mon père, né en novembre 1900 qui devait entrer en 4° au lycée de Laon et Andrée née en 1902. Son beau-frère, Paul Cluet, né en 1975, tient au village un hôtel-retaurant-épicerie, avec son épouse Marthe Pezier dont les parents sont maraîchers à Compiègne. Ils ont une fille, Germaine née en 1902. Maurice Houssel et Paul Cluet sont mobilisés. Trosly dans la zone envahie: Lors de l'offensive des Allemands qui conduit à la première bataille de la Marne, début septembre 1914, les trois villages susnommés, sont envahis sans avoir été évacués. Lors de leur repli sur la rive droite de l'Aisne, Trosly-Loire est l'un des premiers villages près du front. Mon père, Robert, se retrouve dans la zone occupée avec sa mère, sa soeur, sa tante et sa cousine. L'occupation est très dure. Les hommes de 18 à 60 ans ont été faits prisonniers civils et envoyés en Allemagne . Mon père ne peut pas continuer ses études et se retrouvera sans diplôme. Les jeunes gens doivent travailler pour les occupants, en particulier dans les champs. Ils essaient de ravitailler les leurs avec ce qu'ils dérobent. Lors du repli des Allemands sur la ligne Hindenburg (Arras, la Fère, Reims) pour raccourcir leur front, Trosly-Loire est dans la zone qu'ils abandonnent. Ils y pratiquent la politique de la terre brûlée : destruction des villes et des villages et localement, du château de Coucy, ce que les Français ne leur pardonnent pas (arbres fruitiers abattus, sources empoisonnés...). Les familles où il y a des personnes en âge de travailler sont déplacées près de la frontière belge, pour celles de Trosly à Aubenton près de Vervins, où les habitants doivent trouver de la place pour les loger. Des convois sont organisés sous sauvegarde de la Suisse pour rapatrier les plus jeunes et les mères avec des enfants en bas âge. Germaine Cluet en fait partie en juillet 1917 et finit par rejoindre sa famille de Compiègne, d'où elle pourra donner des nouvelles de ceux qui sont restés. Les jeunes gens sont envoyés en Allemagne à pied, ceux de Trosly en octobre 1918 avec un troupeau de vaches. Le 11 novembre, ils arrivent à la frontière belge à Malmédy, à 11h : Vous êtes libres disent leurs gardes. Ils reviendront à pied jusqu'à Sedan, les vaches servant de moyens d'échange pour la nourriture et le logement. Les grands-parents sur la rive gauche de l'Aisne : le grand-père Houssel est resté à Sermoise avec des vieux. Un quotidien national lui consacre un reportage sous le titre De l'administration parmi les ruines . L'ofensive allemande à partir du front de Soissons à Reims en juin 1918 qui aura franchi la Marne à Dormans le contraint à l'exode. Avant de partir, il met à l'abri les archives municipâles dans le caveau de famille au cimetière. Il est réfugié à Charolles (Saône-et-Loire) avec sa fille qui était directrice d'école à la Ferté-Milon. La grand-mère Cluet d'Amblemy est réfugiée à Grenoble. La 2° victoire de la Marne du 18 juiet au 6 août repousse les Allemands sur l'Aisne. Trosly est libérée par l'offensive finale de Mangin qui commence le 29 septembre. Le retour au pays : Les grands parents se retrouvent à l'école de la Ferté-Milon qui était indemne, ainsi que la famille de mon père, leur village ayant subi après les destructions de février 1917 les combats de la reconquête. Les premiers habitants à être rentrés leur décrivent la vie dans les caves, abris de fortune et baraques. A son retour, mon grand-père fait la classe avec le carton goudronné comme tableau et le plâtre en guise de bâton de craie. Le Comité Américain pour les Régions Dévastées avec la fille du banquier Morgan se fixe à Blérancourt, le bourg voisin. Gaston Héricault qui en est originaire et organisera les coopératives de reconstruction, décrit la période dans son livre Terres assassinées devant les dévastations, 1914-1933 (éditions Sirey,1934). De nombreuses correspondances conservées, des photos, des journaux et des documents laissés par les soldats Allemands témoignent de cette histoire. || 1-Photo de ma grand-mère Cluet 2-Photo de jeunes de Trosly 3-Photo de mon grand père Houssel 4-Registre de marchandises 5-Carte de travail de Robert Houssel
FRBNFM- 040 Histoire d'une famille lorraine frontalière pendant la Grande Guerre
1 Item
- Un carnet de notes manuscrites d'aout 1914 - Une carte postale donnée suite à une souscription pour un monument à la mémoire des prisonniers morts au camp de Grafenwôhr - Une carte postale envoyée par la mère du soldat Thirion prisonnier en Allemagne - Un dessin d'un juif polonais réalisé à Vilnius sur du papier toilette dans un camp de prisonniers || La famille de Mme Thirion habitait en Lorraine. Une partie de sa famille (maternelle) était donc allemande depuis 1870 et l'autre partie de sa famille (paternelle) était française alors qu'elles habitent à quelques kilomètres de distance. Le père de Mme Thirion, Emile Thirion, a fait son service militaire en 1910 et a donc été mobilisé en août 1914 en tant que caporal d'infanterie. Il tient un journal de bord en août 1914, jusqu'au 25 août 1914, jour où il est blessé dans la forêt de Pierrepont au bras car la balle qui l'a touché a été détournée par une médaille religieuse. Fait prisonnier fin août 1914, il est conduit au camp de Kassel puis en mai 1916 à Vilnius où il doit effectuer des travaux forcés. Mathématicien et physicien de profession, il obtient de devenir géomètre pour un tracé de route et réussit à s'échapper. Repris, il est tenu prisonnier à Graffenworth en Bavière à partir de mars 1917. Il est transféré dans un camp à Bayreuth de mai 1918 à janvier 1919. De retour en France à Châlons le 26 février 1919, il est libéré de ses obligations militaires en juillet 1919 à Bar le Duc. Le père de Mme Thirion a donc été prisonnier français en Allemagne, son grand père maternel de nationalité allemande (mais lorrain)a été tué par les français et son grand oncle de nationalité allemande s'est échappé du front de Flandre mais est arrêté par les soldats britanniques pour suspicion d'espionnage au service des Allemands.